Les personnes handicapées en Belgique disposent d’une protection constitutionnelle, de droits spécifiques garantis par la loi, d’une protection contre la discrimination, d’un accès à des aides financières et matérielles, et d’une protection juridique adaptée.
L’ensemble de ces droits vise à assurer l’inclusion, l’autonomie et l’égalité réelle dans la société belge.

- Principes fondamentaux et cadre constitutionnel
- Cadre légal et protection contre la discrimination
- Droits fondamentaux spécifiques
- Reconnaissance et accès aux aides
- Protection juridique
- Cadre international
- Quels sont les recours en cas de non-respect des droits des personnes handicapées en Belgique ?
Principes fondamentaux et cadre constitutionnel
Depuis le 30 mars 2021, l’article 22ter de la Constitution belge garantit à chaque personne en situation de handicap le droit à une pleine inclusion dans la société, y compris le droit à des aménagements raisonnables.
Ce droit constitutionnel impose aux législateurs (fédéral, régional, communautaire) de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’égalité et l’inclusion des personnes handicapées.
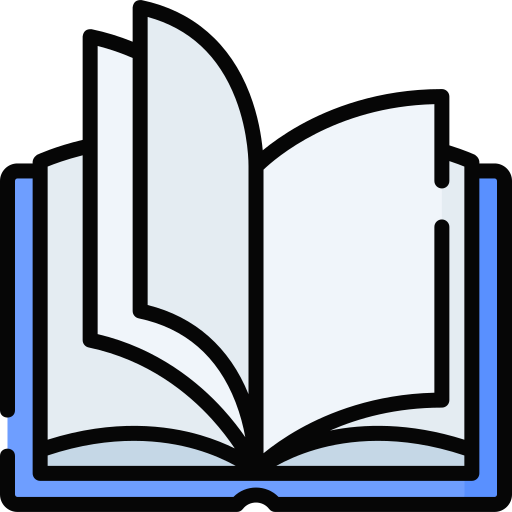
Cadre légal et protection contre la discrimination
- Loi anti-discrimination de 2007 : elle interdit toute discrimination fondée sur le handicap dans l’emploi, l’accès aux biens et services, l’éducation, les soins de santé, etc. Cette loi protège contre les refus d’aménagements raisonnables et garantit l’égalité de traitement.
- Obligation d’aménagements raisonnables : les employeurs, écoles, services publics et autres institutions doivent mettre en place des mesures concrètes pour réduire les obstacles rencontrés par les personnes handicapées. Ces aménagements sont obligatoires sur demande, sauf si cela représente une charge disproportionnée.
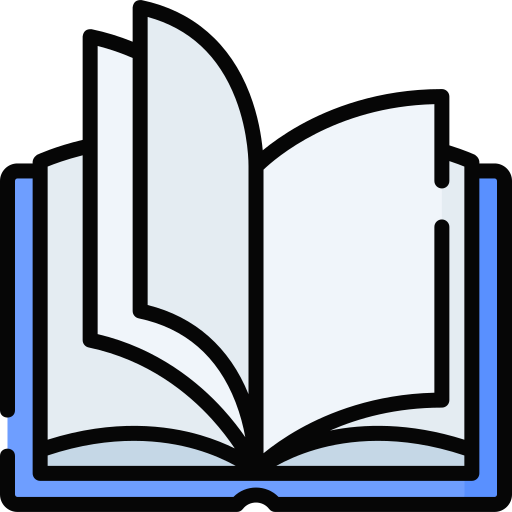
Droits fondamentaux spécifiques
Les personnes handicapées bénéficient des mêmes droits humains que toute autre personne, avec des droits spécifiques, notamment :
- Droit à l’égalité et à la non-discrimination
- Droit à l’autonomie et à une vie sociale active
- Droit à un logement adapté
- Droit à l’éducation avec soutiens spécifiques
- Droit à l’emploi avec mesures d’inclusion
- Droit à l’accessibilité des lieux, services et transports
- Droit à la protection juridique adaptée (voir la loi de 2013 sur la protection des majeurs vulnérables).
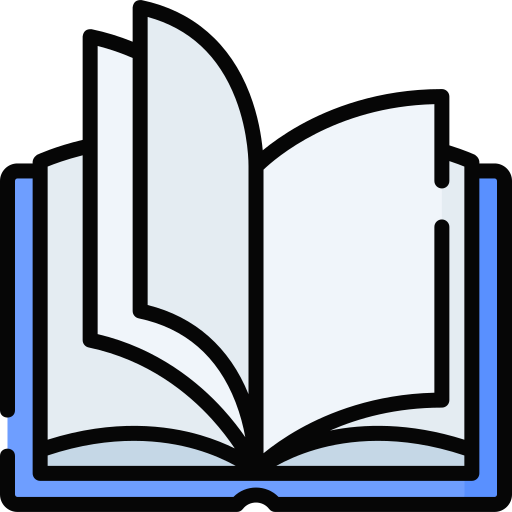
Reconnaissance et accès aux aides
Pour bénéficier de certains droits et aides spécifiques, une reconnaissance officielle du handicap est nécessaire, généralement via la Direction Générale des Personnes Handicapées (DGPH) ou les organismes régionaux.
Cette reconnaissance ouvre l’accès à :
- Allocations financières (allocation de remplacement de revenus, allocation d’intégration, etc.)
- Avantages sociaux et fiscaux (tarif social énergie, carte de stationnement, European Disability Card)
- Aides à la mobilité et à l’accessibilité
- Statut de bénéficiaire de l’intervention majorée (BIM) auprès des mutuelles.

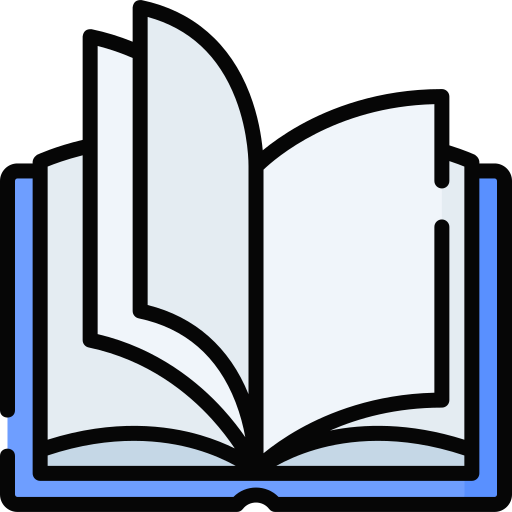
Protection juridique
Depuis 2013, la Belgique a réformé les régimes de protection des personnes majeures handicapées pour privilégier l’autonomie et la dignité.
Deux systèmes existent :
- Protection extra-judiciaire (mandat anticipé)
- Protection judiciaire (administration des biens et/ou de la personne, décidée par le juge de paix)
Ces dispositifs visent à préserver au maximum le pouvoir décisionnel de la personne, avec une approche individualisée et inclusive.

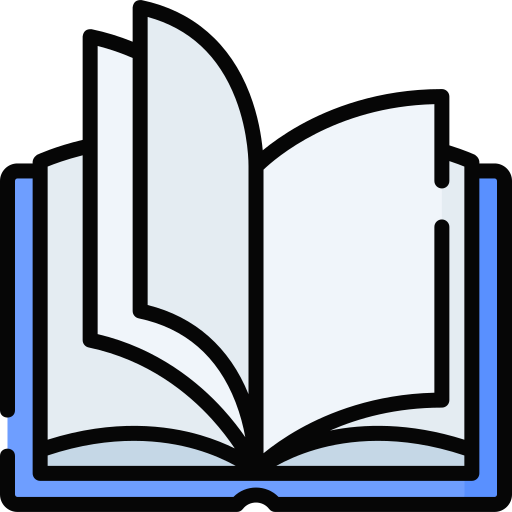
Cadre international
La Belgique a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées en 2009. Ce traité engage le pays à garantir l’égalité, l’inclusion et la participation des personnes handicapées dans tous les aspects de la vie sociale, économique, culturelle et politique.
Quels sont les recours en cas de non-respect des droits des personnes handicapées en Belgique ?
En Belgique, plusieurs recours existent en cas de non-respect des droits des personnes handicapées, qu’il s’agisse d’un refus d’aménagement raisonnable, d’une discrimination ou d’une décision administrative défavorable.
RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES
- Commission de réexamen : pour les décisions d’organismes comme le Service PHARE (Bruxelles), la première étape consiste à demander un réexamen devant la Commission de réexamen. Ce recours est simple, rapide et gratuit, et doit être introduit dans le mois suivant la notification de la décision contestée.
- Tribunal du travail : si la décision de la Commission de réexamen ne donne pas satisfaction, ou directement après une décision administrative, un recours peut être introduit devant le Tribunal du travail. Ce recours est également gratuit et peut être introduit dans le mois suivant la notification. L’assistance d’un avocat est possible mais non obligatoire.
- Conseil d’État : pour contester la légalité d’une décision administrative, un recours en annulation ou en suspension peut être introduit devant le Conseil d’État dans les 60 jours suivant la notification. Cette procédure est plus longue et peut engendrer des frais.
RECOURS EN CAS DE DISCRIMINATION OU DE REFUS D’AMÉNAGEMENT RAISONNABLE
- Plainte auprès d’Unia : en cas de discrimination fondée sur le handicap (refus d’aménagement raisonnable, accès refusé à un service, etc.), il est possible de déposer plainte auprès d’Unia, l’institution publique belge de lutte contre la discrimination. Unia accompagne les victimes dans leurs démarches et peut intervenir à l’amiable ou en justice.
- Procédure judiciaire : une plainte peut être déposée auprès de la police ou directement devant le tribunal compétent, avec l’aide d’un avocat ou d’une association spécialisée. La loi anti-discrimination protège spécifiquement contre les discriminations liées au handicap.
AIDE JURIDIQUE ET ACCOMPAGNEMENT
- Aide juridique gratuite : les personnes handicapées peuvent bénéficier de conseils juridiques gratuits via des associations spécialisées (ex. DHEI, Handydroit/ESENCA, réseau SAM).
- Associations de défense : de nombreuses associations (Unia, DHEI, GAMP, etc.) offrent un soutien pour la rédaction des recours, la médiation ou l’accompagnement devant les tribunaux.
RECOURS COLLECTIFS ET INTERNATIONAUX
- Réclamations collectives : des associations peuvent introduire des réclamations collectives auprès d’organismes internationaux comme le Comité Européen des Droits Sociaux (CEDS) en cas de violation systémique des droits (ex. manque de places d’accueil).
- Actions devant les instances européennes ou onusiennes : en cas d’épuisement des voies de recours internes, il est possible de saisir la Cour européenne des droits de l’homme ou le Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU.




